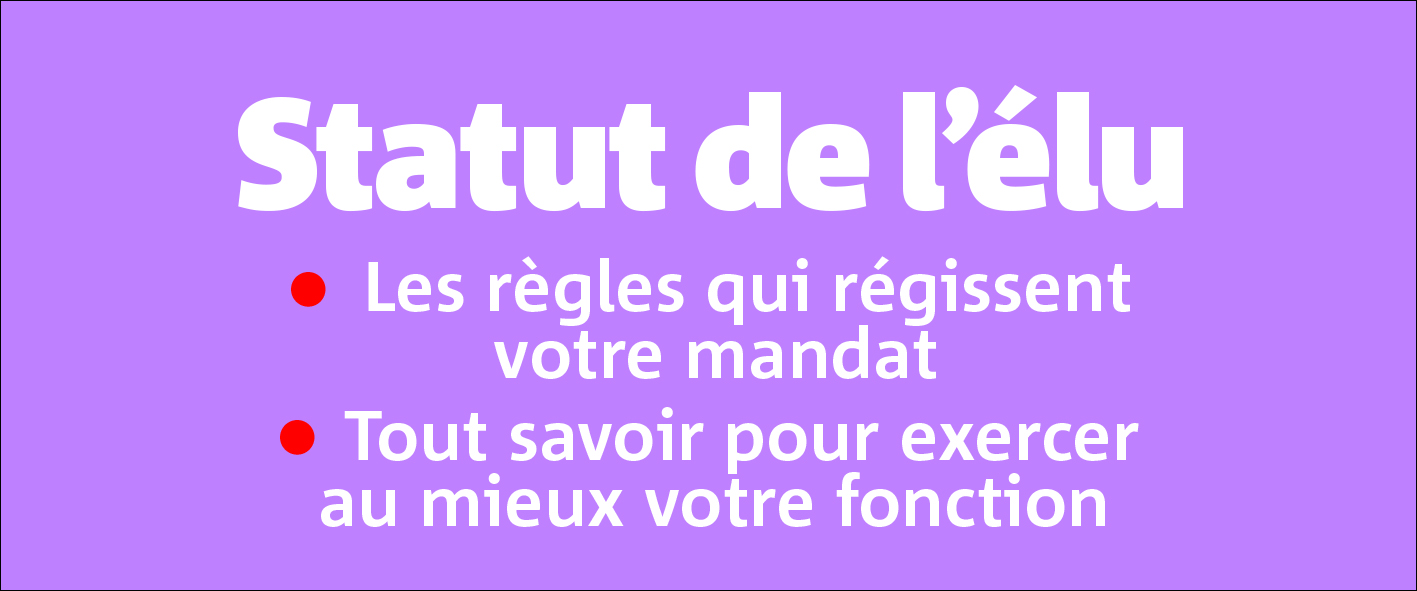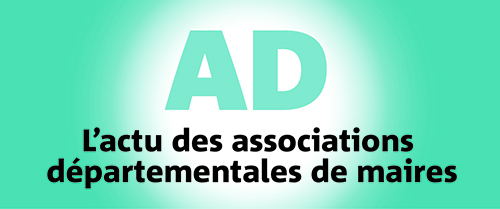03/11/2025
OCTOBRE 2025
- n°438
IA, Numérique, réseaux sociaux
Les maires au cœur des territoires connectés
Si la mutualisation des investissements s'impose, l'implication des communes dans le projet est la garantie de leur succès.
Par Olivier Devillers

© Mairie de Louhans
À Louhans (71), des capteurs intelligents ont été installés sur des lampadaires pour analyser, anonymement, la fréquentation des parkings ou le flux des piétons. Objectif : améliorer le cadre de vie.
À Pezou (1 100 habitants, 41), le maire, Pierre Solon, est à l’affût de toutes les innovations susceptibles d’améliorer le service aux habitants ou de générer ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Raccourci : mairesdefrance.com/28690
Cet article a été publié dans l'édition :
n°438 - OCTOBRE 2025
- Sécurité civile : la Seine-Maritime fédère les acteurs
- Élus et cadres dirigeants : la clé du mandat repose sur une relation de confiance
- André Laignel : " La décentralisation doit reposer sur la confiance, la liberté et la responsabilité "
- Municipales : la parité progresse en trompe-l'œil
- Polices municipales : concrétisation retardée
- Marchés publics : les attentes des eurodéputés
- Eau : priorité à " l'utilisation rationnelle " pour Bruxelles
- Les maires au cœur des territoires connectés
- Dinan Agglomération (22) a créé un réseau de DGS et de secrétaires généraux de mairie
- Démocratie locale : les élus stimulent l'engagement des citoyens
- Handicap : accueillir tous les enfants à l'école
- Aubagne (Bouches-du-Rhône) renforce sa coopération policière
- Plouha (Côtes-d'Armor) veut "fabriquer du commun" avec sa maison des jeunes et de la ruralité
- Rockwool : l'usine dont le maire ne veut toujours pas
- Michel Labardin, maire de Gradignan (Gironde), soutient la lecture publique
- Financer la réparation ou la reconstruction d'un pont
- Espaces sans tabac : comprendre la nouvelle règlementation
- Le transfert de la compétence « assainissement des eaux usées »
- Travailler avec... les Fredon
- Municipales 2026 : le mémento du candidat
- Qualité de l'eau : surveillance
- Logement : révision du zonage
- Fibre : aide aux raccordements complexes
- Comment lutter contre la prolifération des pigeons ?
- Qu'est-ce que le nouveau service 17Cyber ?
- Campagne électorale : un salarié peut-il s'absenter pour y participer ?
- Scrutin de liste paritaire : quel impact en 2026?
- Municipales 2026 : les moyens de propagande officielle
- La maire et la nef
- Le dessin du mois d'octobre 2025
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).