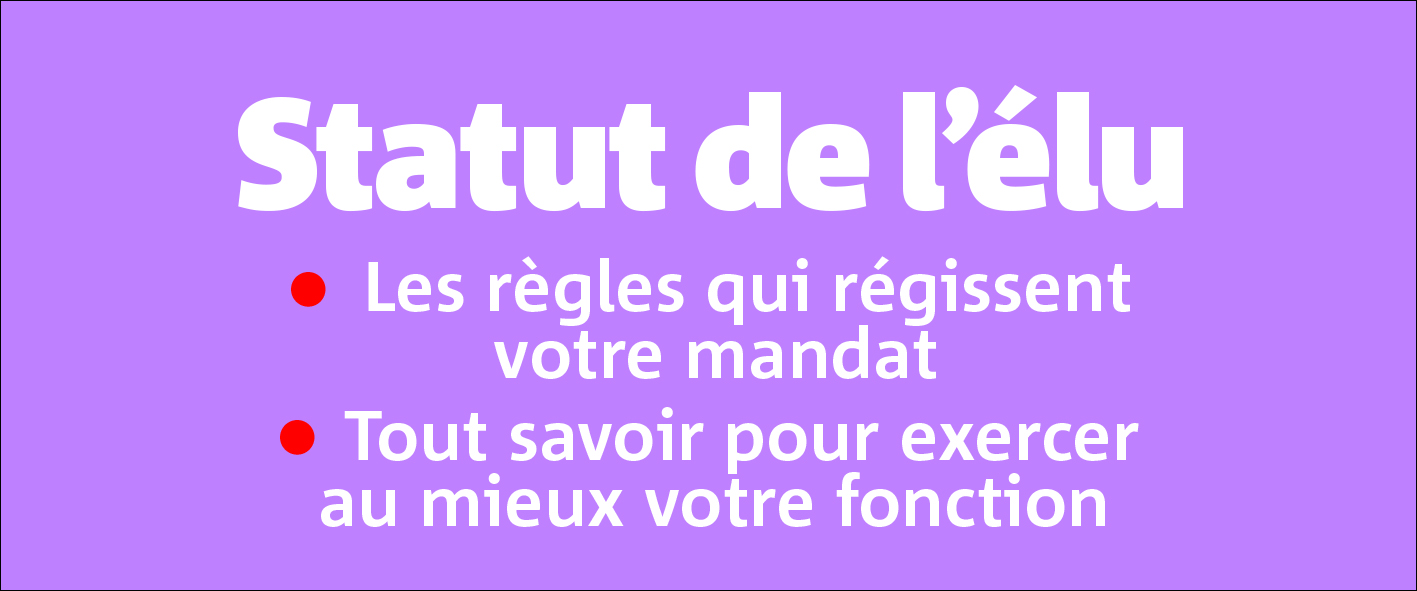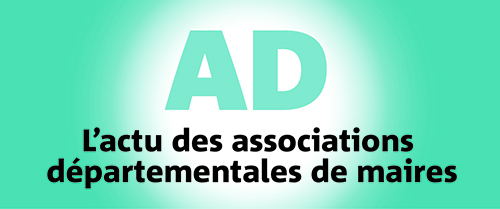23/06/2025
JUIN 2025
- n°435
Environnement
Eau et assainissement : délégation et mutualisation des compétences
Le transfert de ces deux compétences aux communautés de communes, au 1er janvier 2026, n'est plus obligatoire. Communes et EPCI ont d'autres choix.
Par Anne Gardère, avocate au Barreau de Lyon

© Adobestock
En revanche, lorsque les communes n’ont pas encore transféré la gestion de l’eau et de l’assainissement à leur CC, à la date de la promulgation de la loi, elles disposent de trois possibilités : conserver ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Cet article a été publié dans l'édition :
n°435 - JUIN 2025
- AMF 72. Secrétaires généraux de mairie
- Le dessin du mois de juin 2025
- Finances. Les élus critiquent le calcul du Dilico
- Comptes publics : désaccords entre l'État et les élus
- Carte scolaire : une coopération avant toute évolution
- Santé : le gouvernement propose un «pacte» contre les déserts médicaux
- Cohésion : le Parlement européen exprime ses attentes
- AMF 49. Missions culturelles
- AMF 77. Accueillir les étudiants en médecine
- AMF 02. Réunions avec le centre de gestion
- AMF 46. Annonce d'un décès
- Sécurité des ponts : le financement pose question
- Le Pays de Thiérache (Aisne) lutte contre le gaspillage alimentaire
- Transformer une ancienne friche en levier économique
- Préserver la qualité de l'eau : un défi quotidien
- Santé mentale. Trois initiatives pour améliorer la prise en charge
- Le Port emploie des jeunes en service civique solidarité seniors
- Opération stérilisation de chats errants
- Il accueille le Tour de France
- Cybersécurité : trouver les bons interlocuteurs
- Surveiller l'exposition aux ondes électromagnétiques
- Eau et assainissement : délégation et mutualisation des compétences
- Risques inondations : de nouveaux outils pour les maires
- Débroussaillement : faire respecter les obligations
- Secrétaires généraux de mairie : tout savoir sur leur statut
- Espaces publics : aide à la location
- Journée nationale de la résilience : appel à projets
- Santé mentale : les ressources pour les élus et les agents
- La communication institutionnelle en période préélectorale
- Administration : délivrance des certificats de décès par les infirmiers
- Cirques : demandes d'occupation du domaine public
- Municipales 2026 : généralisation du scrutin de liste paritaire
- Transports : renforcement de la sécurité
- Est-il encore possible de solliciter les fonds européens ?
- Quel est le délai pour élaborer un plan intercommunal de sauvegarde ?
- Est-il possible de recruter un contractuel pour remplacer l'absence d'un agent permanent ?
- Municipales 2026 : anticiper le passage de flambeau
- La réinsertion professionnelle après le mandat
- Le maire et le souverain pontife
Les offres d’abonnement
Toutes les éditions
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).