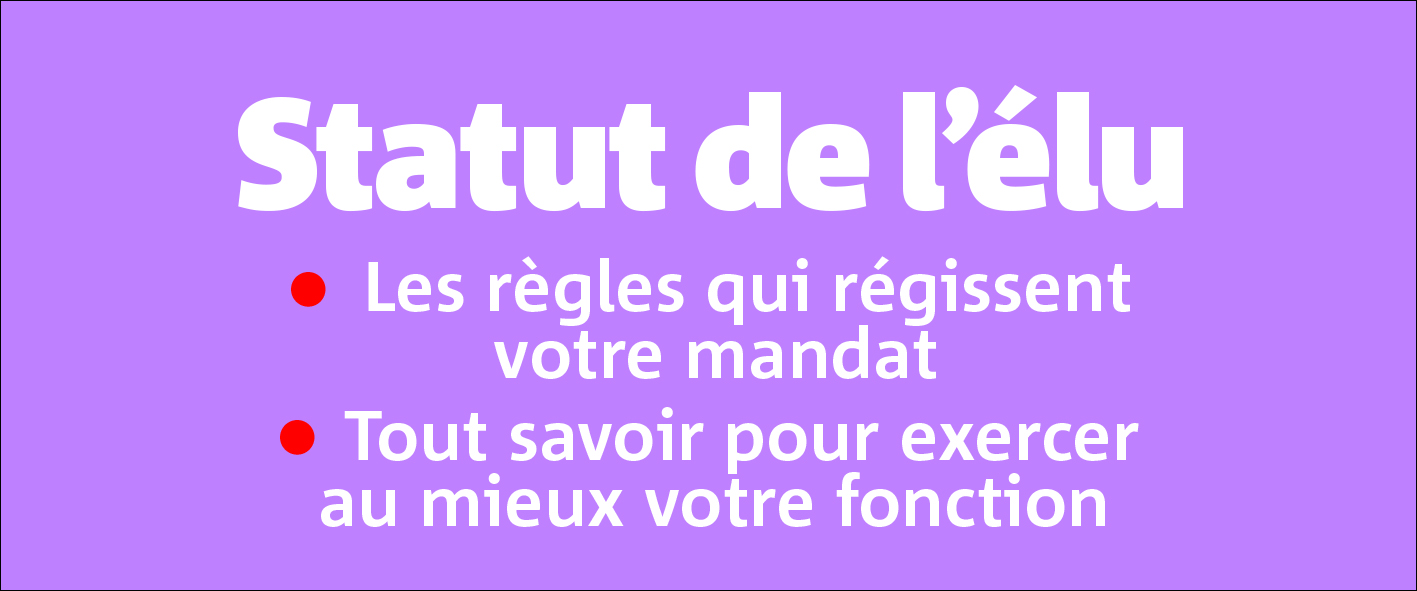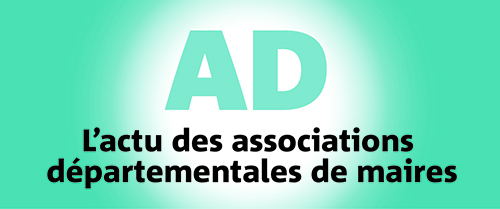Responsabilité financière : des risques contentieux accrus pour les élus
Le nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics aboutit à la condamnation d'élus locaux. Maires de France rappelle les nouvelles règles et les risques encourus.

Sans qu’il y ait remise en cause du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, tous les gestionnaires publics sont susceptibles de voir mise en jeu leur responsabilité avec des conséquences personnelles et pécuniaires : en clair, l’obligation de payer une amende pour des fautes reconnues comme «graves » pour ...
La suite de l'article est réservée aux abonnés...
Déjà abonné ? Se connecter
 Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
Accédez à tous les contenus de Maires de France en illimité
 Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
Bénéficiez d’une offre de référence éditée par l’AMF
 Choisissez le tarif qui vous correspond
Choisissez le tarif qui vous correspond
Raccourci : mairesdefrance.com/28478
Cet article a été publié dans l'édition :
- Joli mois de mai : participez !
- Municipales 2026 : le scrutin de liste est généralisé
- Cohésion de l'Union européenne : priorité à la gouvernance territoriale
- Ruralité : une pétition pour le programme Leader
- Villes : nouveau programme européen
- Fonds structurels : investissement prioritaires
- Communication : un nouveau réseau de " conseillers "
- Pour une Europe numérique
- Déserts médicaux dans l'Union européenne
- Un nouvel espace web pour les AD !
- AMF 15 : gestion de l'emploi
- Femmes et ruralité : échanges entre élues à l'AMF 29
- AMF : sensibilisation à la gestion des risques
- AMF 21 : célébration
- AMF 43 : salon
- AMF 40 : l'IA en vedette
- AMF 09 : salon des communes et des EPCI
- Sécurité : les plans départementaux laissent les élus septiques
- La Roche aux Fées replante des haies
- Maîtriser l'IA générative dans les communes
- Accueil des gens du voyage : mutualiser les actions
- Vic-en-Bigorre (65) délègue la gestion du village seniors
- Issoire et l'armée renforcent leurs liens
- Face à l'avancée de la mer, Wissant est en première ligne
- Il reconvertit la cité industrielle
- Changement climatique : adapter la commune
- Vérifier l'honorabilité des agents et des bénévoles
- Entretien de la voirie : éviter la dette grise !
- Responsabilité financière : des risques contentieux accrus pour les élus
- Sapeurs-pompiers : aptitude et santé
- Transport : renforcement de la sécurité
- Élections municipales 2026 : communication et financement
- Aides à l'électrification en milieu rural
- Ondes électromagnétiques : carte de simulation
- Prêt à taux zéro : les nouveaux critères au 1er avril 2025
- Carte d'identité : un nouveau motif pour la renouveler
- Santé : lutte contre le frelon asiatique
- Petite enfance : schémas de l'offre d'accueil
- Eau et assainissement : gestion des compétences
- Engagement municipal. Les maires ont un rôle à jouer
- Intercommunalité : la recomposition de l'organe délibérant
- Le maire et les parcelles
- Le dessin du mois de mai 2025. Frelons : la peur est dans le pré !
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).