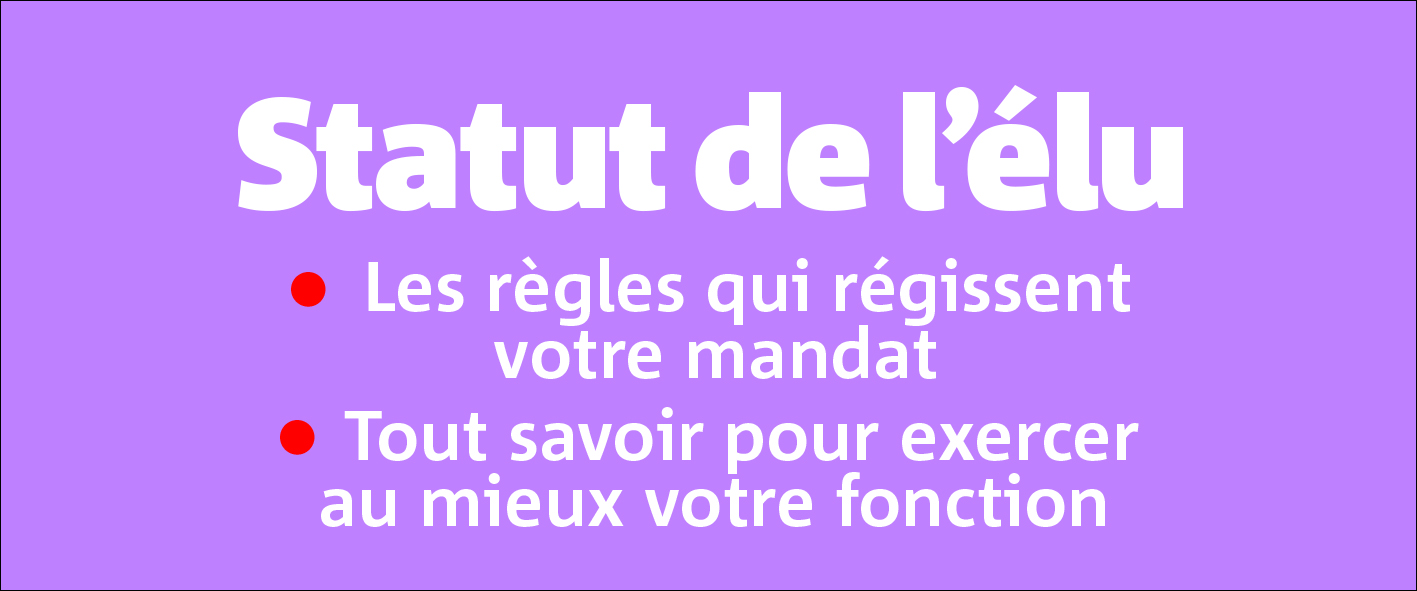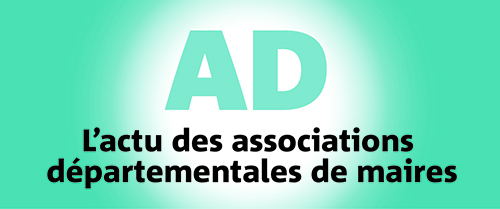Le maire et le respect de la laïcité
Ordonnateur des deniers publics, employeur des agents publics et gestionnaire du domaine public, le maire est en première ligne dans l'application du principe de laïcité.

I - Les fonds publics
Interdiction des subventions au culte. L’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des églises et de l’État énonce que la République «ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ».
En conséquence, une commune ne peut pas verser une subvention à une association cultuelle (définie par la même loi comme celle ayant «exclusivement pour objet l’exercice d’un culte ») et doit vérifier que les fonds versés à une association de droit commun ne contribuent en rien au financement d’un culte. Cette interdiction s’applique en métropole (à l’exception des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle) et, en Outre-mer, seulement sur le territoire de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélémy et Saint-Martin.
Associations mixtes. Le Conseil d’État considère désormais que les associations «mixtes » (c’est-à-dire exerçant à la fois des activités cultuelles et des activités culturelles) peuvent recevoir une subvention publique dès lors que l’objet de la subvention revêt un intérêt public local (par exemple la construction d’un orgue installé dans l’église mais servant à la fois aux messes et au conservatoire municipal) et que des garanties sont apportées (notamment via la conclusion d’une convention) en ce qui concerne les conditions d’emploi de la subvention, permettant d’exclure toute aide directe à un culte (CE, 19 juillet 2021, Commune de Trélazé, n° 308544).
Écoles confessionnelles. Par exception à la loi de 1905, la loi Debré du 31 décembre 1959 (aujourd’hui codifiée à l’article L.442-5 du Code de l’éducation) fait obligation aux communes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des écoles sous contrat d’association avec l’État, même lorsque leur caractère propre est d’ordre confessionnel, «dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public ».
Édifices. Concernant les lieux de culte, le maire doit distinguer trois cas : les édifices dont la commune est demeurée ou devenue propriétaire, et pour lesquels elle peut prendre en charge les dépenses d’entretien, de réparation et d’accessibilité ; les édifices dont les associations cultuelles sont propriétaires, pour lesquels la commune ne peut financer que les travaux de réparation et d’accessibilité ; les édifices cultuels n’appartenant ni aux communes, ni à des associations cultuelles et pour lesquels aucune participation financière publique n’est admise.
Mise à disposition. Si la commune ne saurait contribuer au financement de l’édification d’un lieu de culte, en revanche, le juge admet que des salles municipales soient mises temporairement à la disposition d’associations cultuelles, pour l’exercice d’un culte, sous réserve que cette mise à disposition ne constitue pas une libéralité. Récemment, le Conseil d’État a précisé que l’existence d’une libéralité (interdite) «ne saurait résulter du simple fait que le local est mis à disposition gratuitement » et qu’elle doit être «appréciée compte tenu de la durée et des conditions d’utilisation du local communal, de l’ampleur de l’avantage éventuellement consenti et, le cas échéant, des motifs d’intérêt général justifiant la décision de la commune » (CE, 18 mars 2024, n° 471061).
II - Les agents publics
Neutralité des agents publics. L’article L.121-2 du Code général de la fonction publique dispose que «dans l’exercice de ses fonctions, l’agent public est tenu à l’obligation de neutralité », qu’il «exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité » et qu’« à ce titre, il s’abstient notamment de manifester ses opinions religieuses ». Il en résulte que le fait pour un agent du service public de «manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion, constitue un manquement à ses obligations » et justifie donc une sanction disciplinaire (CE, avis, 3 mai 2000, n° 217017).
L’obligation de neutralité s’applique quelles que soient les fonctions de l’agent ; il est indifférent que l’agent n’encadre pas de subordonnés ou ne rencontre jamais d’usagers. Cette obligation s’applique également aux agents de droit privé affectés à un service public, par exemple dans une régie chargée d’un service public industriel et commercial ou dans une entreprise privée délégataire d’un service public, comme l’a confirmé la Cour de cassation (Cass., soc., 19 mars 2013, n° 12-11690).
Liberté de conscience. La liberté de conscience et d’opinion étant garantie aux agents publics, il est strictement interdit au maire de tenir compte des opinions religieuses d’un agent ou de leurs manifestations en dehors du temps de service pour prendre des décisions relatives à son affectation ou au déroulement de sa carrière.
Autorisations d’absence. Pour le Conseil d’État, «l’institution par la loi de fêtes légales ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sous réserve des nécessités du fonctionnement normal du service, des autorisations soient accordées à des agents publics pour participer à d’autres fêtes religieuses correspondant à leur confession » (CE, 12 février 1997, n° 125893). Il n’existe toutefois aucun droit individuel aux autorisations d’absence qui serait opposable au maire et celui-ci ne peut accorder que des autorisations compatibles avec les nécessités du service.
Situation des élus. L’article L.2122-34-2 du Code général des collectivités territoriales, créé par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, dispose, certes, que le maire ainsi que les adjoints et les conseillers municipaux délégués «sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité » mais seulement «pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État » (c’est-à-dire notamment lorsqu’ils interviennent comme officier d’état civil – par exemple pour la célébration des mariages – ou comme officier de police judiciaire ou comme président d’un bureau de vote).
En revanche, lorsqu’ils agissent en qualité d’élu communal, aucune obligation de neutralité ne pèse sur eux, en l’état actuel du droit. Comme l’a jugé la Cour de cassation, aucune disposition législative «ne permet au maire d’une commune, dans le cadre des réunions du conseil municipal, lieu de débats et de confrontations d’idées, d’interdire aux élus de manifester publiquement, notamment par le port d’un insigne, leur appartenance religieuse », sous peine de commettre le délit de discrimination (Cass. crim, 1er sept. 2010, n° 10-80.584).
III - L’espace public
Apposition de signes religieux. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit «d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions ». La loi ne s’oppose donc pas au maintien, sur leur emplacement actuel, des signes religieux qui auront été installés avant la loi du 9 décembre 1905 ; elle prohibe seulement l’installation de nouveaux signes religieux. En revanche, donner à une voie publique le nom d’une personnalité religieuse n’est pas contraire à la loi de 1905 puisque ce nom, quelles que fussent les fonctions religieuses de l’individu ainsi honoré, n’est pas, en lui-même, un signe religieux.
Carrés confessionnels. L’article L.2213-9 du Code général des collectivités territoriales interdit que les inhumations donnent lieu «à des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
En conséquence, pour le Conseil d’État, «l’institution de carrés confessionnels dans les cimetières n’est donc pas possible en droit », même s’il relève qu’en pratique, de tels carrés ont été encouragés par les circulaires de plusieurs ministres de l’Intérieur «afin de répondre aux demandes des familles, de confession musulmane notamment, de se voir créer dans les cimetières des lieux d’inhumation réservés à leurs membres » (rapport public du Conseil d’État 2004, p. 327).
Sonneries de cloches. Il appartient au maire de réglementer les sonneries des cloches en conciliant les nécessités de l’ordre public et le respect de la liberté des cultes : il lui est loisible de limiter la durée de chaque sonnerie à dix minutes, mais pas de l’interdire dès qu’il fait nuit (CE, 26 mai 1911, 35843).
• Dossier du Conseil d’État de décembre 2024, « Le juge administratif et l’application du principe de laïcité »
• Circulaire du 10 février 2012 du ministre de la Fonction publique sur les autorisations d’absence
Raccourci : mairesdefrance.com/28604
Cet article a été publié dans l'édition :
- Municipales 2026. Trois Français sur quatre jugent positivement le bilan de leur maire
- À nos lecteurs. Pause estivale pour Maires de France - L'Hebdo
- Contractualisation : améliorer les dispositifs
- Le maire et les pollueurs
- Le dessin du mois de juillet-août 2025
- UMEE 27 : gérer les biens sans maître
- État civil : peut-on se passer du papier ?
- Agressions d'élus. La communication est essentielle
- Hélène Guillet, présidente du SNDGCT. "Nous alertons sur une forme d'automatisation des sanctions financières"
- Plan France ruralités. Un recyclage de dispositifs sans moyens supplémentaires
- Préserver l'économie sociale et solidaire
- Zones rurales : le Parlement européen s'invite au débat
- Gouvernance de l'Union européenne : ne pas oublier les élus
- Politique de cohésion : préserver sa raison d'être
- Temps de travail : la France pointée du doigt
- Loup : statut définitivement révisé
- AMF 63. Secrétaire général de mairie : à vos diplômes!
- AMF 10 : lutter contre les dépôts sauvages
- AMF 34 : maîtriser l'usage de l'intelligence artificielle
- AMF 33 : violences intrafamiliales
- Agrivoltaïsme. Son développement fait débat
- La Gironde remodèle son aide sociale à l'enfance
- Lutter contre les violences dans le sport
- Chamonix-Mont-Blanc anticipe le risque glaciaire
- Montélimar agglomération lutte contre les frelons asiatiques
- Tempête-submersion. La Rochelle organise un test XXL
- Gil Avérous, maire de Châteauroux, favorise l'implantation de pensions de famille
- Élections : comprendre la loi sur le scrutin de liste paritaire
- Sécurité des élus : un " pack " mis à leur disposition
- Développer le stationnement intelligent
- Le maire et le respect de la laïcité
- Comptabilité : compte financier unique
- Santé mentale : conseils locaux
- Bureaux, bâtiments : faciliter leur transformation
- Urbanisme : prolongation des délais
- Narcotrafic : mesures concernant les maires
- Vignes en friche : attention aux propriétaires négligents !
- Fortes chaleurs : de nouvelles obligations
- Le refus d'accueillir un cirque ou une fête foraine doit-il être motivé ?
- Reconversion professionnelle : un élu doit-il prendre des précautions ?
- Comment bénéficier du programme national pour l'entretien des ponts ?
- Ma santé d'abord. Ces maires qui agissent
- Site internet, réseaux sociaux : les règles à respecter
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).