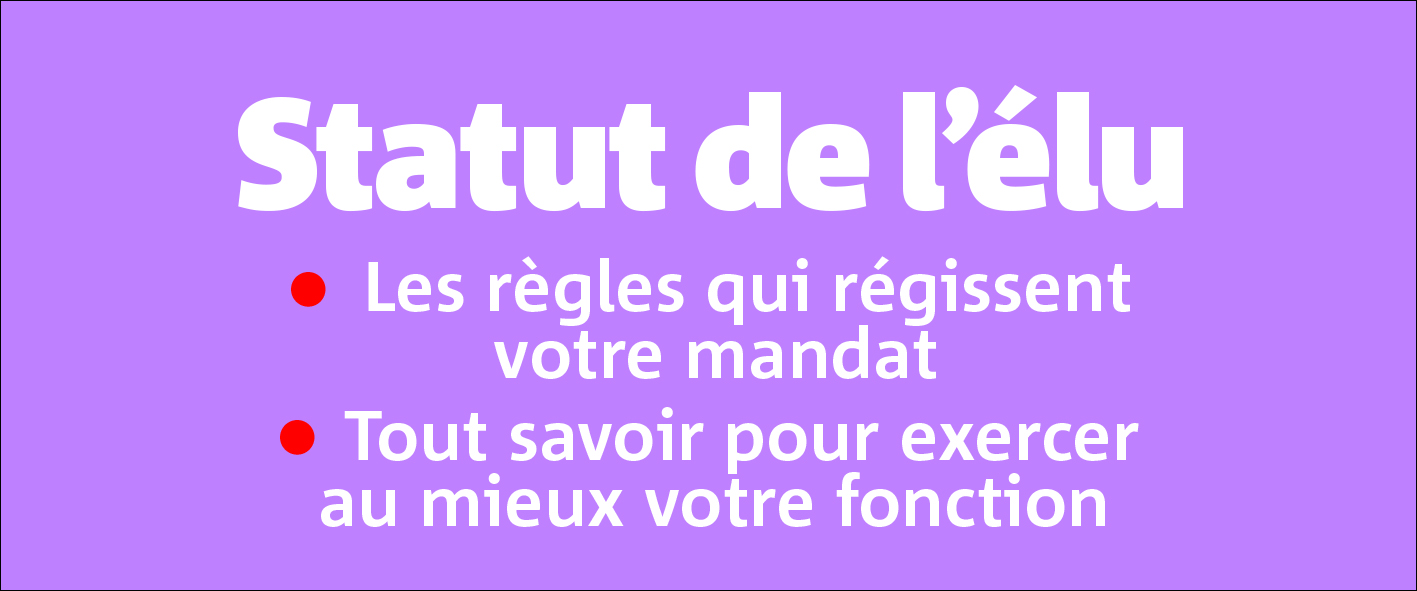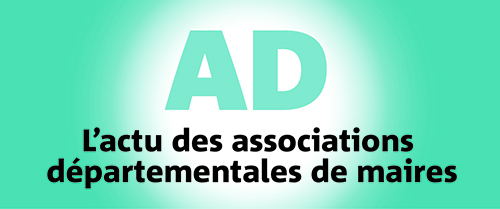Le projet de budget européen ne fait pas l'unanimité
Les crédits consacrés à la politique de cohésion baisseraient. La gouvernance inquiète les élus locaux qui dénoncent une recentralisation.

Sur un budget européen total de 1 980 milliards d’euros, ce fonds serait doté de 865 milliards, dont 90,1 milliards pour la France. On est loin des deux tiers du budget européen que représentent historiquement ces deux politiques traditionnelles de l’Union européenne.
Pour allouer cet argent, les États élaboreront des «plans de partenariat nationaux et régionaux » (PPNR). C’est la recentralisation que nombre d’acteurs redoutaient, même si le mot «régional » a été accolé in extremis aux «plans nationaux » initialement envisagés.
Dans ce nouveau méga-fonds, 452 milliards d’euros sont alloués à la «cohésion économique, territoriale et sociale, y compris la pêche et les communautés rurales et le tourisme ». Mais au sein de cette enveloppe, seules les régions «moins développées » se voient octroyer un montant défini. Ce sera «au moins » 3,67 milliards pour la France. Sur la base des PIB par habitant régionaux 2021-2023, cette catégorie englobera les Outre-mer mais également, si les critères ne changent pas, la Picardie, la Lorraine et le Limousin, dont la moyenne du PIB par habitant tombe sous les 75 % de la moyenne de l’Union européenne.
Les autres régions resteraient en catégorie «transition » et «plus développées », qui n’ont donc pas d’allocations prédéfinies dans la proposition de la Commission européenne. Ce sera aux États membres de décider des ressources à y allouer.
Les élus déplorent une « renationalisation »
Pour ce qui est de la politique agricole commune, au moins 300 milliards d’euros sont réservés au soutien des agriculteurs. Le programme Leader consacré au développement rural est maintenu, de même que les groupes d’action locale (GAL) qui le mettent en œuvre. Mais lui non plus ne dispose pas d’enveloppe prédéfinie. Ici encore, ce sera aux États membres de choisir.
À Bruxelles, le 18 juillet, le ministre délégué chargé de l’Europe, Benjamin Haddad, a surtout promis de se battre «pour chaque centime de la politique agricole commune », insistant sur la nécessité d’avoir un budget qui donne «de la visibilité aux revenus de nos agriculteurs, pour leur donner les moyens d’investir, pour aider les jeunes agriculteurs ».
La cohésion ? Elle «sera bien sûr au cœur des discussions », a-t-il affirmé. À côté des chiffres, les modalités de mise en œuvre de la future politique de cohésion posent question. Difficile de dire à ce stade ce qu’il adviendra des «programmes opérationnels », traditionnellement rédigés par les régions, ni même du rôle de ces dernières en tant qu’autorités de gestion.
La proposition de la Commission se réfère bien au principe de «partenariat », laisse à chaque État membre la possibilité d’inclure des «chapitres » régionaux dans le plan qu’il remettra à la Commission européenne et n’empêche pas de désigner des autorités de gestion identiques à celle de la programmation 2021-2027.
Comment tout cela se traduira-t-il concrètement dans chacun des États membres ? Régions de France s’en inquiète. Dans un communiqué du 24 juillet, et en écho au Comité européen des régions, l’association dénonce la logique de renationalisation à l’œuvre sous couvert des «plans nationaux et régionaux ».
La politique de cohésion, insistent les élus, est «une politique territorialisée qui doit répondre d’abord et avant tout aux besoins de développement exprimés par les élus locaux et les acteurs régionaux ». Régions de France demande que leur fonction d’autorités de gestion soit conservée.
« Remettre en cause la territorialisation de la politique de cohésion, c’est saper un des fondements de la construction européenne », estime, pour sa part, Philippe Laurent, vice-président de l’AMF et président de l’Association française du conseil des communes et régions d’Europe (AFCCRE), dans un communiqué du 17 juillet.
Thibaut Guignard, co-président de la commission Europe de l’AMF, alerte lui aussi. «Il y a ce que permet la Commission européenne et ce que les États membres en font. Et on sait qu’en France, et notamment à Bercy, on a quand même des pro-centralisation. »
Les collectivités locales d’Europe trahies
Le maire de Plœuc-L’Hermitage (Côtes-d’Armor) s’inquiète également de l’avenir du programme Leader. «On peut se dire qu’il est cité dans les documents, donc que c’est une bonne chose. Et on peut être un peu plus pessimiste en se disant que s’il n’y a pas de minimum financier, certains États membres, dont la France, risquent de le faire passer à la trappe. »
« La Commission européenne n’en fait qu’à sa tête. Les collectivités locales d’Europe ont été trahies », réagit, pour sa part, Christophe Rouillon, co-président de la commission Europe de l’AMF. «Libre aux autorités nationales de fixer le cadre des dépenses, sur le modèle de ce qui a été fait avec le plan de relance européen. Or, on sait que ce plan n’a pas été un succès partout, notamment pour ce qui est de l’implication des territoires. »
Pour le maire de Coulaines (Sarthe), la Commission européenne menace la politique de cohésion basée sur une programmation à long terme définie sur la base de priorités communes. «Pourquoi faire remonter de l’argent à Bruxelles si c’est pour le faire redescendre vers les États membres afin qu’ils le répartissent selon leurs propres priorités ? », s’interroge l’élu (lire également le communiqué de presse de l’AMF). Le projet de budget fera l’objet de négociations entre la Commission et chaque État membre jusqu’en 2027.
• 452 milliards d’euros pour la «cohésion économique, territoriale et sociale, y compris la pêche et les communautés rurales et le tourisme ».
• 217,7 milliards d’euros pour les régions les moins développées, dont 3,67 milliards pour la France.
• 10,2 milliards d’euros pour la coopération territoriale (Interreg), dont 13,6 % pour la France.
• 300 milliards d’euros pour la politique agricole commune (PAC, hors Leader).
• 40,8 milliards d’euros pour Erasmus+.
• 14 % des dotations nationales à flécher vers les objectifs sociaux de l’UE, dont les emplois de qualité, les compétences, l’inclusion sociale et le logement.
• 35 % des dépenses pour le climat et l’environnement.
Raccourci : mairesdefrance.com/28623
Cet article a été publié dans l'édition :
- Le dessin du mois de septembre 2025
- 107e Congrès des maires 2025 : premières informations
- Baisse du Fonds vert : les acteurs locaux adaptent leurs stratégies
- Le projet de budget européen ne fait pas l'unanimité
- Andam : rendez-vous début 2026
- AMF 07 : pour une jeunesse engagée !
- AMF 33 : municipales 2026
- AML 45 : tout savoir sur le scrutin de liste
- Service public départemental de l'autonomie : privilégier la proximité
- Fibre : Survilliers (95) s'oppose aux installations anarchiques
- La communauté de communes de la Plaine de l'Ain mise sur le développement du tourisme vert et responsable
- Zan : les élus en terrain instable
- Trois initiatives pour sécuriser les transports scolaires
- L'agglomération du Pays de l'or (Hérault) aide les saisonniers à se loger
- Allonnes (Sarthe) soutient la tenue des classes " au dehors "
- Breil-sur-Roya (Alpes-Maritimes) cherche assureur désespérement
- Gwen Guillerme, maire de Lizio (Morbihan), adhére au réseau villes ambassadrices du don d'organes
- Sols pollués : comment gérer le risque
- Jumeau numérique, un outil d'aide à la décision pour les communes
- Municipales 2026 : le financement de la campagne électorale
- Travailler avec le ministère des Armées
- Enchères : bonnes affaires en ligne
- Injures, diffamation, menaces entre candidats: quels recours et quelles sanctions ?
- Un maire versant une prime illégale à ses agents agit-il par intérêt personnel ?
- Pouvoirs du préfet renforcés
- Développement local : classement en FFR+
- Accessibilité : l'État met la pression
- Détenus : pas de vote par correspondance en 2026
- Un nouveau décret étend les espaces sans tabac
- Accueil du jeune enfant : référentiel national
- Carrière ou mandat : le dilemme des maires
- Municipales 2026 : qui peut être candidat?
- Le maire et les cercueils
Maires de France est le magazine de référence des maires et élus locaux. Chaque mois, il vous permet de décrypter l'actualité, de partager vos solutions de gestion et vous accompagne dans l'exercice de votre mandat. Son site Internet, mairesdefrance.com, vous permet d’accéder à toute l'information dont vous avez besoin, où vous voulez, quand vous voulez et sur le support de votre choix (ordinateur, tablette, smartphone, ...).